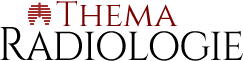Le scanner en première intention pour l'exploration du cœur ?
LUNDI 03 NOVEMBRE 2014 Soyez le premier à réagir
Soyez le premier à réagirParce qu'il apporte plus de confort au patient et qu'il est moins coûteux que les techniques d'exploration invasives, le coroscanner pourrait devenir, à terme, l'examen de première intention pour l'étude des coronaires. Les techniques de scanographie de perfusion pourraient, de plus, lui donner une rôle croissant dans l'évaluation de la fonction myocardique lors de syndromes aigus coronariens.

Les spécialistes de l'imagerie cardiovasculaire s'accordent à dire que les récentes évolutions technologiques concernant le scanner en font, aujourd'hui, l'examen de première intention pour l'étude du cœur et de sa vascularisation. C'est également ce qui est ressorti du dernier congrès de la Société Internationale de tomodensitométrie cardiovasculaire (SCCT), où il a été convenu que le scanner pouvait désormais réunir l'ensemble des techniques d'exploration diagnostiques invasives en une seule discipline non invasive.
Les apports du coroscanner pour le confort des patients
La première des techniques concernées est la coronarographie percutanée. La tomodensitométrie (TDM) seule est aujourd'hui capable d'évaluer si les artères coronaires sont normales ou si elles présentent des lésions non significatives. Une étude de 2010 montrait que, sur un échantillon de 376 000 coronarographies diagnostiques percutanées, 62% étaient normales ou montraient des lésions mineures. Pour le Dr Matthew Budoff, de l'Harbour UCLA Medical Center en Californie, il est temps que la TDM devienne l'examen de première intention pour cette région anatomique, afin notamment de réduire le nombre d'actes invasifs pratiqués, pour le confort des patients et pour réduire les coûts de prise en charge. Sans compter les progrès réalisés dernièrement en termes de dosimétrie pour ce type d'exploration.
La TDM pour l'étude fonctionnelle du myocarde
Mais ce n'est pas tout. Dans les cas de lésions significatives, les cathétériseurs ont pris l'habitude, depuis quelques années, d'évaluer l'impact de ces lésions sur la fonction myocardique. Ils utilisent pour cela des dispositifs de Fractional Flow Reserve (FFR) qui étudient le débit des artères en amont et en aval de la sténose pour en déduire son impact sur l'irrigation du myocarde. Cette technique est moins souvent utilisée aujourd'hui, les alternatives comme l'IRM de perfusion ou la scintigraphie l'ayant rapidement détrônée. Mais le scanner porte désormais sa candidature pour cette évaluation, grâce au développement de la perfusion, avec le CT-FFR. Le Dr Mathew Budoff a présenté, lors du SCCT, de nouvelles études randomisées destinées à comparer la CT-FFR et la FFR percutanée. Les premiers résultats de ces études sont de nature à favoriser à brève échéance la CT-FFR, qui utilise des algorithmes très sophistiqués permettant d'évaluer la pression et le débit sanguin sur l'ensemble de l'arbre coronaire en une seule mesure. Cela lui donne un avantage certain sur la pratique invasive qui ne peut étudier qu'une seule sténose à la fois, notamment à l'occasion de syndromes coronariens aigus.
Le scanner cardiaque est, nous l'avons compris, le prochain examen de première intention pour étudier les coronaires du point de vue morphologique, mais également fonctionnel. Il peut, de plus, être encore amélioré avec les nouvelles avancées technologiques de la TDM, parmi lesquelles la TDM spectrale qui, grâce à des rayonnements de différentes énergies, peut identifier, voire soustraire les images de calcifications endovasculaires. La coronarographie diagnostique a donc du souci à se faire...
Bruno Benque