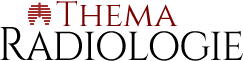À quand un Big Bang du droit de l'imagerie médicale ?
MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 Soyez le premier à réagir
Soyez le premier à réagirNesrine Benyahia est docteure en droit public spécialisée en analyse des systèmes de santé, en droit des nouvelles technologies et en droit de l’imagerie médicale et exerce aujourd’hui au sein du Cabinet Houdart & Associés. A l’occasion des JFR 2017, elle établit un bilan du cadre juridique et tarifaire de l’imagerie médicale afin d’alerter les pouvoirs publics sur la nécessité d’agir de façon structurelle sur ce secteur.

Thema Radiologie : Vous avez exercé pendant plusieurs années dans l'industrie de l'imagerie médicale. Vous souhaitez aujourd'hui l'avènement d'un Big Bang du droit dans ce secteur. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette notion ?
Nesrine Benyahia : Le terme Big Bang, qui désigne scientifiquement le concept «d’explosion originelle » dans le domaine de la physique quantique, renvoie à la notion de bouleversement. Le droit de l’imagerie médicale a aujourd’hui besoin de ce bouleversement, d’une transformation d’ampleur. Le droit doit pouvoir évoluer en fonction des objectifs fixés par les pouvoirs publics dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Ces objectifs sont notamment une meilleure accessibilité aux examens d’imagerie sur tout le territoire français, une action publique fortement axée sur la prévention (Plans Cancer), une maîtrise efficiente des dépenses d’imagerie, et surtout un soutien tarifaire crédible des actes et équipements innovants.
T.R.: Qu'attendez-vous à moyen terme de cette transformation ?
N.B.: Les objectifs sont multiples et les enjeux associés sont majeurs. En effet, la France fait face à une augmentation incontrôlée des dépenses d’imagerie (+11,3% des dépenses d’imagerie dans le secteur libéral entre 2007 et 2014, soit 400 millions d’euros supplémentaires. Source : CNAMTS, Sniiram, Cour des comptes 2016).
Pour autant, le délai d’obtention de rendez-vous pour un examen d’IRM reste élevé selon la dernière étude INCA de 2013 (23 jours dans le cas d’un cancer du sein, 28 jours dans le cas d’un cancer de la prostate). Il semble pertinent de souligner l’absence de mise à jour de l’étude INCA depuis 2013, mais également le nombre important de biais dans cette étude. La seule étude annuelle des délais qui soit crédible est celle d’Imagerie Santé Avenir (ISA), un consortium d’industriels de l’imagerie, étude désormais sous la responsabilité du SNITEM. En sus du caractère subjectif de cette dernière, des biais restent également notables.
En somme, l’imagerie médicale souffre de la fragilité des données de son secteur. A l’heure du Big Data, il est temps de décloisonner ces données et de leur réserver une vraie place dans la définition de la politique nationale d’imagerie.
T.R.: Selon vous, quels sont les principaux leviers de transformation du droit de l’imagerie médicale ?
N.B.: Réformer l’imagerie médicale, c’est agir de façon synergique sur quatre principaux leviers que j’appelle les TEPO : Tarification, Évaluation, Pertinence, Organisation. La stratégie nationale de santé en matière d’imagerie médicale doit alors prendre en considération ces quatre leviers en déterminant les outils adaptés.
Tout d’abord, l’argent est le nerf de la guerre dit-on, c’est encore plus vrai dans le secteur de l’imagerie. L’unique levier qui est véritablement considéré par les pouvoirs publics est le levier tarifaire. Néanmoins, les enjeux économiques ne doivent pas prédominer sur les enjeux de santé publique. La maîtrise des dépenses d’imagerie étant devenue une obsession, comme nous pouvons le constater suite aux nombreuses mesures de baisses tarifaires qui ont eu lieu ces dix dernières années, sans atteindre les résultats escomptés de réduction des dépenses. Au contraire, cette obsession a conduit à de mauvaises pratiques, à une dégradation de la qualité des examens et à des inégalités d’accès aux soins. Le patient demeure l’unique perdant. C’est pour cela qu’il faut redonner au levier tarifaire son rôle premier d’outil de régulation et non d’outil de définition et de détermination des politiques publiques.
Ensuite, l’objectif de régulation de l’activité et des dépenses d’imagerie médicale nécessite une évaluation objective des besoins de la population (via la mesure des taux de recours aux examens) et une évaluation des possibilités offertes par le parc des équipements déjà installés. Cette évaluation n’est aujourd’hui pas effectuée et elle manque cruellement à la définition d’une politique publique justifiée et crédible. Cette évaluation pourra notamment être d’une grande d’aide dans la définition d’une stratégie médico-économique.
T.R.: Comment agir pour une meilleure pertinence et une meilleure organisation des soins ?
N.R.: La pertinence des soins en imagerie médicale est cruciale, non seulement d’un point de vue économique (diminution ou suppression de tarification des actes non pertinents), mais également d’un point de vue sanitaire (réduction de l’exposition à des rayonnements ionisants, amélioration du parcours de soins). Agir sur les prescriptions des examens grâce à un outil d’aide à la décision clinique pourrait améliorer la pertinence des examens réalisés in fine. Par ailleurs, le PLFSS 2018 prévoit 225 millions d’euros d’économie sur les actions de pertinence et d’adaptations tarifaires de certains actes médicaux incluant les actes d’imagerie.
Enfin, l’organisation des soins dans le secteur de l’imagerie médicale est un pilier de l’organisation territoriale de l’offre de soins centrée sur le rôle régulateur des agences régionales de santé (ARS). Le pilotage national de l’installation des équipements d’imagerie médicale constitue le cœur de la politique publique dans ce secteur. En effet, le régime des autorisations actuel ne permet pas de répondre aux besoins des patients et ne conforte pas non plus les comptes de l’Assurance Maladie.
À suivre...
Propos recueillis par Bruno Benque