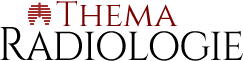Permanence des soins en imagerie : ce que l’on attend des projets pilotes
SAMEDI 25 MAI 2013 Soyez le premier à réagir
Soyez le premier à réagirLa DGOS a retenu 3 régions (Lorraine, Picardie et Pays de la Loire), pilotes pour la permanence des soins en imagerie, dans l’objectif de capitaliser sur leurs expériences. Cette action permettra de proposer, pour toute la France, des recommandations de bonnes pratiques et d’expérimenter des modèles de financement reproductibles. Quels enseignements se dégagent, 1 an plus tard, de ces projets ?
La permanence des soins en imagerie médicale fait partie des 5 chantiers prioritaires de déploiement de la télémédecine au plan national et constitue l’un des 3 axes choisis par la DGOS, en 2012, pour identifier les modèles de bonnes pratiques à diffuser sur la France entière. En raison de leur maturité dans ce domaine, 3 régions pilotes ont été retenues et bénéficient d’un accompagnement.
Évelyne Satonnet, chef du bureau Coopérations et contractualisations à la DGOS, revient sur les premiers enseignements de ces pilotes : « Les éléments techniques sont prêts. Les organisations en télémédecine offrent le moyen de professionnaliser l’organisation des gardes et des astreintes. Avec l’ensemble des membres de l’équipe projet nationale chargée du suivi, notamment l’ASIP Santé et l’ANAP, nous mettons en place des modules – référentiels métiers et organisationnels... – permettant, dans un premier temps, l’accompagnement des projets. Ces modules seront ensuite utilisés comme outils dans le cadre du déploiement, prévu au deuxième semestre 2014. »
En Pays de la Loire
« Notre projet est conduit par un comité de pilotage présidé par l’ARS, auquel participent les représentants du G4[1] régional, des fédérations et le GCS, en accompagnement méthodologique et technique », décrit Matthieu Capon, chef de projet au GCS e-santé Pays de la Loire. Il rappelle les 3 axes qui guident les orientations stratégiques relatives à l'imagerie médicale : favoriser un accès égal (y compris aux équipements lourds) ; s'assurer de l'efficience du fonctionnement des matériels, de la pertinence des actes et de la maîtrise des risques associés, en évitant la réalisation d’actes d'imagerie conventionnelle non indiqués ou redondants ; mobiliser les TIC et le potentiel de la télémédecine et maintenir une organisation de l'imagerie médicale qui garantisse une PDS mutualisée.
Fin 2012, la première étape s’est achevée, avec la production de 4 livrables : un état des lieux, une étude d’apport des TIC à la téléradiologie, un accompagnement à la définition du schéma d'organisation médicale mutualisée de la PDS en imagerie et l’élaboration de recommandations pour une réponse régionale.
« Après un découpage autour des filières de soins des 2 CHU, la deuxième étape, prévue pour juin 2013, passe par un pilote régional sur 2 bassins : la Sarthe et la Vendée », précise le chef de projet. Résultats attendus au second semestre 2013.
En Lorraine
Le projet lorrain s’appuie, lui, sur plusieurs années de coopération, notamment entre l’hôpital de Freyming-Merlebach et le CHU de Nancy. « Dès 2010, nous avons déployé un outil – T-Lor – sur l’ensemble des services d’urgences de notre région, explique Christian Badinier, Directeur du GCS Télésanté Lorraine. Il est composé d’une partie « équipement » et d’un outil de workflow qui permet de gérer les téléconsultations et télé-expertises, ainsi que le transfert de patients. Les établissements se sont appropriés le dispositif, d’autant qu’il offre aux professionnels la possibilité d’assurer les astreintes depuis leur domicile, grâce à une clé 3G.»
Le processus est simple. Le radiologue d’astreinte reçoit des images. Il effectue le compte rendu, qu’il envoie ensuite au clinicien. Il peut suivre le dossier en temps réel par un système d’alerte via SMS. Quand le dossier part de l’établissement, un SMS informe le radiologue de son arrivée sur sa session. Un nouveau SMS avertit le clinicien de la prise en charge de son dossier par le radiologue. Après interprétation et envoi du compte rendu, le clinicien reçoit une nouvelle alerte, lui précisant que celui-ci est à sa disposition.
« Les professionnels y voient l’avantage de pouvoir télétravailler, commente Christian Badinier, et l’établissement apprécie une meilleure disponibilité du professionnel, un gain de temps sur la prise en charge du patient et une diminution de la durée de passage aux urgences. » Le système autorise également la mutualisation des ressources. « Une étude terrain a montré qu’un radiologue prend en charge l’équivalent de 3 établissements périphériques, c’est-à-dire 3 astreintes simultanées. Cette organisation fonctionne et a l’approbation des professionnels. Nous pallions ainsi au manque de radiologues, leurs astreintes sont mieux réparties et nous offrons une meilleure qualité de service avec plus de traçabilité ! Les comptes rendus ne sont plus oraux mais rédigés immédiatement à l’aide de documents types. Reste la question de la rémunération car le radiologue a une volumétrie d’actes naturellement supérieure. Mais nous travaillons sur ce point avec la DGOS. »
En Picardie
« Nous exploitions depuis 1 an une solution de télémédecine permettant une expertise en imagerie, expose Benoît Normand, RSI Santé à l’ARS Picardie, et l’adaptation de cette solution à la PDS reposait principalement sur des questions d’organisation et de convention entre établissements. Dans le contexte actuel de ressources médicales rares, les avantages sont nombreux : gain en temps médical, coopération entre les établissements, adhésion des professionnels mais aussi des patients, qui « réinvestissent » l’hôpital. De plus, dans un petit service d’urgences, il est rassurant de pouvoir recueillir l’avis de spécialistes pour transférer le patient vers l’établissement le plus adapté. Le système donne la possibilité de court-circuiter les pratiques « informelles » de télémédecine – envoi par smartphone d’une image à un collègue, par exemple », apprécie-t-il.
Sylvain Gallet, Directeur de projet Télémédecine au GCS e-santé Picardie, explique le principe : « les établissements demandeurs possédant un plateau technique envoient des images à des établissements effecteurs, via la plate-forme COMEDI-e®[2], donnant ainsi lieu à leur interprétation et à la réalisation d’un compte rendu formalisé. À ce jour, en PDS, cela est effectif dans la demi-heure qui suit la réception de l’image. En continuité des soins et sans caractère d’urgence, c’est J+1. À titre d’exemple, pour les « établissements demandeurs » de Montdidier et Albert – en radiologie conventionnelle programmée –, les examens sont analysés par le CHU d’Amiens. Nous avons démarré la PDS en téléradiologie au CH de Péronne, pour lequel les examens de scanner sont interprétés par le CH de Saint-Quentin les nuits, week-ends et jours fériés. Si les aspects techniques sont derrière nous, il reste à travailler le modèle économique, sans oublier qu’en PDS, c’est l’organisation des hommes et des volontés qui est primordiale ! »
Le Dr Christine Boutet-Rixe, Directrice médicale au GCS, précise : « Avant ce déploiement, nous avions réalisé une expérimentation sous l’impulsion du Pr Hervé Deramond, Chef de service du pôle imagerie du CHU d’Amiens, et sollicité l’avis des professionnels de santé afin que les solutions techniques et organisationnelles répondent à leurs besoins. Aujourd’hui, l’adhésion est là et les retours sont unanimes. La répartition de la charge permettant aux établissements effecteurs d’absorber cette activité supplémentaire est bien gérée, mais nous restons vigilants pour ne pas emboliser l’activité du site. Nous commençons à avoir des indicateurs d’évaluation : les établissements qui ont mis en place une téléradiologie ont gardé une patientèle, voire ont augmenté leur activité en examens externes. »
[1]Conseil professionnel de la radiologie française
[2] COopération MEDicale Innovante en e-santé ; le service de téléradiologie est opéré par CGTR.
4 monographies instructives
Outre ces chantiers pilotes, 4 exemples d’organisation de la permanence des soins en imagerie ont été développés dans le cadre des monographies télémédecine proposées par l’ANAP l’an passé. Ils portent sur Telurge et le projet de la Fédération inter-hospitalière d’imagerie médicale Flandre-Lys, en Nord-Pas-de-Calais, la téléimagerie au CHU de Fort-de-France (qui a malheureusement dû être interrompue depuis), et le réseau Aquitaine Télé-Radiologie.
Marie-Valentine Bellanger