Pr Alain Luciani : même sous forme digitale, les JFR 2020 doivent rester interactives !
À quelques semaines de l’ouverture des JFR 2020, qui seront entièrement digitales (JFR.plus) cette année, nous avons rencontré le Pr Alain Luciani qui préside cet événement. Il évoque avec nous les raisons qui l’ont poussé à abandonner le format hybride initialement prévu, met en lumière les moments forts qui rythmeront ce congrès virtuel et souhaite que ce dernier reste interactif.
Thema Radiologie : Professeur, juste un mot sur l’actualité : les nouvelles ne sont pas rassurantes quant à l’arrivée de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19. Quelle est la situation au sein de votre institution à Créteil ?
Pr Alain Luciani : Étant donnée la recrudescence du virus, on est désormais très vigilants car avec quelques 9 000 cas déclarés tous les jours en ce moment il se peut que la tension revienne dans les établissements de Santé, notamment aux soins intensifs. C’est déjà plus ou moins le cas dans certaines localités, et même si nous ne sommes pas impactés outre mesure, donc nous y prêtons une grande attention.
T.R. : Vous avez la charge de présider les Journées Francophones de Radiologie (JFR) 2020 dans un contexte particulier. Quelles sont vos contraintes majeures aujourd’hui ?
Pr A.L. : La fonction de président des JFR est de réussir à organiser le plus grand congrès de radiologie en présentiel d’Europe (l’ESR le devance en termes de format digital) et d’arriver à drainer le plus de gens de la communauté radiologique pour favoriser les rencontres et les échanges et, également, de faire une belle exposition technique, ce qui est fondamental pour notre spécialité. C’est aussi de la formation continue, donc de l’innovation scientifique. Il faut ainsi prévoir un programme longtemps à l’avance, s’assurer qu’il soit encore d’actualité le jour J et proposer de l’innovant pour que les participants aient envie de revenir. On peut s’appuyer pour cela sur l’équipe de la Société Française de Radiologie (SFR) qui a l’expérience nécessaire et aide le président du congrès afin qu’il puisse évaluer ce qui est faisable ou non.
T.R. : Les JFR 2020 seront donc entièrement sous format digital cette année, comme le fut l’ESR cet été et comme le sera le RSNA en décembre prochain. N’avez-vous pas été tenté de délocaliser le congrès dans un endroit moins touché par la pandémie que la région parisienne afin de sauver la partie présentielle ?
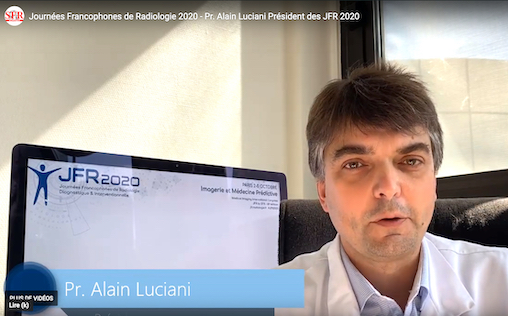
Pr A.L. : Pour comprendre notre démarche, il faut, en fait, remonter dans le temps. Le format actuel a été construit en avril dernier. Cela veut dire que la partie digitale était déjà dans les tuyaux à l’époque, notamment à cause du report de l’ECR de Vienne et de l’annonce de l’annulation du congrès présentiel de la RSNA. Nous avions, à l’époque, décidé d’amblée d’organiser un événement hybride, ce qui correspondait à préparer un contenu digital pour compléter la partie présentielle, sur une plateforme qui constituerait éventuellement le support de tout le congrès en cas d’impossibilité de réunir physiquement les participants. Nous avons ainsi élaboré plusieurs scénarios.
T.R. : Le contenu digital s’imposait donc dans votre esprit, quelle que soit l’évolution du virus ?
Pr A.L. :C’est en effet un accélérateur du savoir et on a besoin d’un contenu scientifique qui va au-delà de 4 jours de congrès car on n’a pas le temps de tout voir en présentiel lors d’un congrès aussi important. On a donc besoin d’un support digital solide pour un accès facilité au contenu scientifique à postériori. Mais nous avons également du présentiel pour les échanges et l’interactivité. La convivialité est très importante et il est essentiel, à cette occasion, de se retrouver entre équipes, avec les constructeurs, avec les manipulateurs, pour échanger sur les pratiques.
En tout cas, les JFR 2020 préfigurent beaucoup de congrès à venir. La partie présentielle, on l’avait prévue allégée, avec des ateliers, des séances interactives et une exposition technique dans son format habituel. C’était notre volonté au départ. Le challenge est aujourd’hui de garder au maximum la notion d’échanges et d’interactivité à travers la plateforme virtuelle. C’est pour ça que les modérations des présentations seront faites en direct pour favoriser l’interactivité, permettre aux congressistes de poser des questions, et d’échanger avec le modérateur. À l’avenir, nous ne souhaitons pas réduire le temps de présentiel car il est essentiel et que le scientifique peut se retrouver à postériori sur les plateformes digitales.
T.R. : Espérez-vous drainer autant de congressistes qu’à l’accoutumée lors des JFR.plus ?
Pr A.L. : Les inscriptions sont en cours d’ouverture, nous n’avons pas de recul, mais déjà les 9 300 membres de la SFR seront là. L’intérêt du digital est aussi de faire participer les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, notamment les étrangers. Depuis avril, on a intégré au processus, pour eux, la partie du programme anglophone ainsi que le contenu hispanophone. En plus de cela, à la demande de chaque congressiste, il sera possible d’obtenir une traduction en anglais et en espagnol de tout le contenu pédagogique en direct, un peu comme les sous-titrages des derniers discours du Président Macron.
T.R. : Quelles seront les thématiques de cette édition 2020 qui, selon vous, sont susceptibles de connaître le plus de succès ?
Pr A.L. : Nous avons, tout d’abord, choisi plusieurs thématiques autour de l’innovation, avec des séances de cas cliniques, une session technologique autour du scanner avancé et du scanner spectral, notamment leurs applications en imagerie de l’abdomen et ostéoarticulaire. Nous avons prévu un deuxième focus dédié à l’imagerie et à la médecine prédictive, qui abordera les avancées scientifiques pour prévenir le handicap ou prévenir certains cancers comme les neuroblastomes.
D’autre part, lors de la conférence Antoine Béclère, on se projette dans l’espace avec une session en partenariat avec le Centre National des Études Spaciales (CNES), le dimanche à 12h. Je pense qu’il y a énormément de synergies entre nos deux spécialités, notamment sur le thème du voyage dans l’espace. Comment, par exemple, embarquer de la très haute technologie radiologique vers Mars, autre que l’échographe ? Comment faire pour accompagner les explorateurs de l’espace avec du matériel de radiologie interventionnelle, dans des voyages depuis lesquels on ne peut pas les ramener ? En termes de synergies, le deuxième axe de réflexion est le traitement d’images, le CNES étant positionné sur l’analyse de l’imagerie terrestre qui reprend beaucoup des outils que nous-mêmes essayons de développer pour améliorer les images médicales.
On va ainsi favoriser les interactions entre les équipes d’ingénierie du CNES et celles qui travaillent sur l’imagerie médicale. Ce sera, j’en suis sûr, un gros temps fort des JFRavec notamment la participation de Claudie Heigneré, la célèbre spationaute française.
T.R. : Le programme prévoit, c’est incontournable, une session consacrée à la pandémie de COVID-19. Comment allez-vous aborder cette thématique ?
Pr A.L. :Un Focus COVID sera effectivement proposé, le lundi 5 octobre, selon trois axes. Tout d’abord un volet scientifique élaboré par la Société d’Imagerie Thoracique. D’autre part, une session traitant des enjeux, dans le futur, de la récession professionnelle et de l’organisation territoriale de l’imagerie sera organisée, avec quatre tables rondes autour de la pandémie COVID, traitant des enjeux de l’après COVID, comment changer l’approche territoriale de l’imagerie, ou d’magerie et gériatrie à l’heure du COVID. J’ajoute que nous diffuserons, le dimanche soir vers 18h, un film hommage aux équipes qui ont assuré la prise en charge radiologique des patients COVID, très émouvant, que l’on avait prévu de projeter dans l’amphi.
T.R. : Qu’avez-vous envie de dire aux acteurs de la communauté radiologique pour les inciter à participer aux JFR .plus ?
Pr A.L. : J’espère simplement que beaucoup de monde va se connecter et que les acteurs de la radiologie francophone, mais pas que, apprécieront l’enjeu d’être présent à cet événement et d’être interactif malgré l’absence de contact physique. Je voudrais souligner ici la possibilité, pour les participants aux JFR.plus, de la mise à disposition en ligne de l’intégralité du contenu scientifique sur la plateforme JFR.365, à partir de 2021. Nous avons mis l’accent, cette année, sur l’imagerie prédictive, sur la pandémie de COVID et sur le positionnement de la radiologie dans la société pour améliorer l’expérience patients. À ce sujet, je voudrais, pour finir, annoncer, le vendredi 2 octobre au matin, un focus sur l’expérience patient et l’amélioration des services rendus aux populations avec une belle présence institutionnelle. Je crois que nous assisterons, je pense, à un beau congrès.
SUR LE MÊME THÈME

L'ECR 2026 consacre une journée entière à l'Alzheimer
L’European Congress of Radiology (ECR) 2026 annonce l’organisation, le 5 Mars 2026, de sa toute première Journée Alzheimer, une extention significative du programme du congrès qui souligne le rôle croissant de la radiologie face à l’un des problèmes de santé publique les plus urgents de notre époque...
11/02/2026 -

L'ECR évolue avec de nouveaux formats proposés
L’European Congress of Radiology (ECR) revient à Vienne comme à chaque fin d’hiver, pour des moments de formation et de partages au sein de la communauté mondiale de l'imagerie médicale.
30/01/2026 -

Les Master class Bracco sont de retour en 2026
Après l’audit par les pairs, deux nouveaux sujets seront traités par des experts à l’occasion des Master class Bracco 2026. Celui du 18 Mars 2026 évoquera l’IA en sénologie, tandis que celui du 2 Avril 2026 aura pour thème principal les infections pulmonaires en radiologie.
21/01/2026 -


L'échographie pour guider les pratiques d'injection d'acide hyaluronique
L’injection d’acide hyaluronique sur le visage peut provoquer un risque d’occlusion vasculaire. Une étude présentée au dernier congrès de la RSNA a montré que l’échographie peut aider à traiter ces complications potentiellement graves. Des injections guidées par l’échographie pourraient également am...
09/12/2025 -

Save the date : les JFR Urgences 2026
La Société Française de Radiologie organise, les 26 et 27 Mars 2026, à l’Hôtel Villa M à Marseille, les JFR Urgences 2026. Cet événement pluriprofessionnel réunira radiologues, MERM, urgentistes, cliniciens spécialisés et soignants de terrain pour deux journées de travail autour de la gestion de la...
03/12/2025 -

Optimisez vos protocoles de TDM grâce aux webinaires Eurosafe Imaging
L’European Society of de radiology (ESR) vient de publier les chiffres d'audience record obtenus par le premier épisode de sa série de webinaires EuroSafe Imaging 2025, « Optimisation en tomodensitométrie : les bonnes pratiques et les erreurs à éviter », qui a été diffusé le 14 octobre 2025.
07/11/2025 -

Record du nombre d'abstracts reçus pour l'ECR 2026 !
L’European Society of Radiology (ESR) vient d'annoncer un nombre record de soumissions de résumés pour son congrès annuel ECR 2026 qui se tiendra du 4 au 8 mars 2026 à l’Austria Center de Vienne (Autriche).
16/10/2025 -
LETTRE D'INFORMATION
Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !
Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.


