Retour sur la réforme du 3ème cycle de formation des radiologues
Le troisième cycle de la formation des radiologues a fait l'objet, en 2017, d'une évolution, tant sur le contenu du cursus que sur sa durée. Le Pr Benoit Schlemmer, grand ordonnateur de cette réforme pour le Ministère, était l'invité principal de la Conférence Antoine Béclère lors des JFR 2017. Retour sur les détails de cette réforme.
La Conférence Antoine Béclère, organisée lors des Journées Francophones de Radiologie (JFR) 2017, avait pour thème la réforme du troisième cycle des études de médecine.
Adapter la formation des radiologues aux standards internationaux
 La formation initiale des radiologues a fait l'objet d'un travail soutenu et collégial des responsables de la Société Française de Radiologie (SFR), de représentants de l'Union Nationale des Internes en Radiologie (UNIR), ainsi que du Collège des Enseignants de Radiologie de France (CERF). Un dialogue constructif s'est engagé avec le Doyen Benoit Schlemmer, chargé de mission auprès du Ministère pour la mise en place de cette réforme, qui était l'invité principal de la Conférence Antoine Béclère 2017. "La réforme du 3ème cycle des études médicales a été initiée afin de mieux répondre aux besoins de Santé et de la rendre plus lisible, notamment à l'étranger, par une adaptation aux standards internationaux, a-t-il déclaré en préambule. Elle assurera un lien entre les formations initiale et continue, ainsi qu'un suivi individualisé des étudiants. Elle intègrera un processus de professionnalisation qui sera une vraie préparation à l'exercice du métier."
La formation initiale des radiologues a fait l'objet d'un travail soutenu et collégial des responsables de la Société Française de Radiologie (SFR), de représentants de l'Union Nationale des Internes en Radiologie (UNIR), ainsi que du Collège des Enseignants de Radiologie de France (CERF). Un dialogue constructif s'est engagé avec le Doyen Benoit Schlemmer, chargé de mission auprès du Ministère pour la mise en place de cette réforme, qui était l'invité principal de la Conférence Antoine Béclère 2017. "La réforme du 3ème cycle des études médicales a été initiée afin de mieux répondre aux besoins de Santé et de la rendre plus lisible, notamment à l'étranger, par une adaptation aux standards internationaux, a-t-il déclaré en préambule. Elle assurera un lien entre les formations initiale et continue, ainsi qu'un suivi individualisé des étudiants. Elle intègrera un processus de professionnalisation qui sera une vraie préparation à l'exercice du métier."
10 modules en radiologie d'organes et en radiopédiatrie proposés en phase d'approfondissement
En pratique, le 3ème cycle de la formation des radiologues comportera une phase socle, pour l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession, une phase d'approfondissement ensuite, et enfin une phase de consolidation. Le Pr Louis Boyer, Président du CERF, a 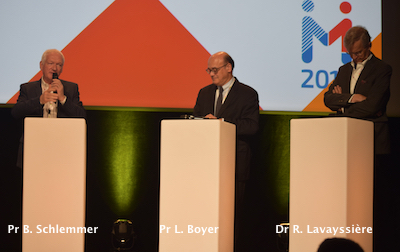 ensuite présenté les détails du cursus de formation. "Il s'agira d'un diplôme unique de radiologie polyvalente et de sur-spécialité, selon une maquette de formation de 9 semestres, a-t-il précisé. Des modules présentiels de base technologique (32h), d'anatomie radiologique (48h) et d'urgence radiologique (20h) seront sanctionnés par une évaluation nationale." Au cours de la phase d'approfondissement, les étudiants pourront se former à la radiologie polyvalente ainsi qu'à une sur-spécialisation. Au cours de la phase de consolidation, enfin, 10 modules radio-cliniques spécialisés en imagerie d'organes et en radiopédiatrie seront proposés.
ensuite présenté les détails du cursus de formation. "Il s'agira d'un diplôme unique de radiologie polyvalente et de sur-spécialité, selon une maquette de formation de 9 semestres, a-t-il précisé. Des modules présentiels de base technologique (32h), d'anatomie radiologique (48h) et d'urgence radiologique (20h) seront sanctionnés par une évaluation nationale." Au cours de la phase d'approfondissement, les étudiants pourront se former à la radiologie polyvalente ainsi qu'à une sur-spécialisation. Au cours de la phase de consolidation, enfin, 10 modules radio-cliniques spécialisés en imagerie d'organes et en radiopédiatrie seront proposés.
Une option d'internat en six ans en Radiologie Interventionnelle Avancée
"La grande nouveauté de ce cursus de formation consiste en l'ajout d'une sixième année d'internat pour ceux qui souhaitent obtenir la spécialité de Radiologie Interventionnelle Avancée (RIA), pour les actes complexes en neuroradiologie, en oncologie ou en vasculaire notamment", conclut le Pr Boyer. Cette option, certifiante mais non exclusive, sera organisée sur le même modèle que pour la formation des chirurgiens et a fait l'objet d'un travail de la Fédération de radiologie interventionnelle de la SFR avec les tutelles pour élaborer une nouvelle classification des actes de RI. Ainsi, l'ensemble des radiologues seront formés aux gestes simples de RI - internat en cinq ans -, tandis que ceux qui auront choisi l'option de RIA pourront pratiquer les actes complexes de RI – internat en six ans -.
Le Pr Schlemmer face aux acteurs représentatifs de la radiologie française
 La dernière partie de la Conférence Antoine Béclère a été consacrée à une interview du Pr Schlemmer par des représentants des différentes branches de la radiologie française. Thibaut Jacques, pour l'UNIR, a questionné le Doyen sur l'organisation du cursus de RIA. "Les étudiants feront la demande d'une sixième année d'internat et c'est l'ARS qui attribuera les postes, selon les besoins régionaux, à partir des proposition des professionnels, répondit le Pr Schlemmer. Les étudiants qui postuleront à cette option en feront la demande auprès d'une structure et devront être acceptés par un maître de stage. La région affectera, en outre, une enveloppe financière pour cette formation." Le Dr Pascal Béroud, représentant les radiologues des Centres Hospitaliers (CH) non universitaires, qui s'interrogeait sur les modalités de participation de ce type d'établissement au processus de formation, le Doyen répondit qu'ils obtiendraient un agrément de l'université pour la phase de consolidation. Les étudiants auront ainsi l'opportunité de connaître différents modes d'organisation et d'avoir une perspective de poste à travers un contrat de professionnalisation. Les maîtres de stage, au sein des CH, seront quand à eux reconnus comme tels par l'Université.
La dernière partie de la Conférence Antoine Béclère a été consacrée à une interview du Pr Schlemmer par des représentants des différentes branches de la radiologie française. Thibaut Jacques, pour l'UNIR, a questionné le Doyen sur l'organisation du cursus de RIA. "Les étudiants feront la demande d'une sixième année d'internat et c'est l'ARS qui attribuera les postes, selon les besoins régionaux, à partir des proposition des professionnels, répondit le Pr Schlemmer. Les étudiants qui postuleront à cette option en feront la demande auprès d'une structure et devront être acceptés par un maître de stage. La région affectera, en outre, une enveloppe financière pour cette formation." Le Dr Pascal Béroud, représentant les radiologues des Centres Hospitaliers (CH) non universitaires, qui s'interrogeait sur les modalités de participation de ce type d'établissement au processus de formation, le Doyen répondit qu'ils obtiendraient un agrément de l'université pour la phase de consolidation. Les étudiants auront ainsi l'opportunité de connaître différents modes d'organisation et d'avoir une perspective de poste à travers un contrat de professionnalisation. Les maîtres de stage, au sein des CH, seront quand à eux reconnus comme tels par l'Université.
Impliquer les étudiants dans la recherche scientifique dès le 2ème cycle
 Dans le cadre de la coopération ville-hôpital, le Dr Lavayssière, représentant les médecins libéraux, a ensuite souhaité savoir si les structures privées pourraient participer au processus de formation des internes. "C'est tout à fait possible, répondit le Pr Schlemmer. Mais cela ne doit pas se limiter au 3ème cycle, c'est une demande formulée par les étudiants qui, en majorité, souhaite connaître le milieu libéral. Cela passe aussi par l'agrément d'un maître de stage." Après un couplet sur la sensibilisation à la pertinence des soins, un sujet très suivi par le Ministère, il a terminé en répondant au Pr Louis Boyer sur le thème de la recherche scientifique. "Les étudiants doivent être impliqués dans la recherche dès le 2ème cycle, a-t-il affirmé. Et nous souhaitons que les parcours de recherche scientifique soient favorisés, en parallèle à l'internat."
Dans le cadre de la coopération ville-hôpital, le Dr Lavayssière, représentant les médecins libéraux, a ensuite souhaité savoir si les structures privées pourraient participer au processus de formation des internes. "C'est tout à fait possible, répondit le Pr Schlemmer. Mais cela ne doit pas se limiter au 3ème cycle, c'est une demande formulée par les étudiants qui, en majorité, souhaite connaître le milieu libéral. Cela passe aussi par l'agrément d'un maître de stage." Après un couplet sur la sensibilisation à la pertinence des soins, un sujet très suivi par le Ministère, il a terminé en répondant au Pr Louis Boyer sur le thème de la recherche scientifique. "Les étudiants doivent être impliqués dans la recherche dès le 2ème cycle, a-t-il affirmé. Et nous souhaitons que les parcours de recherche scientifique soient favorisés, en parallèle à l'internat."
SUR LE MÊME THÈME

L'ECR 2026 consacre une journée entière à l'Alzheimer
L’European Congress of Radiology (ECR) 2026 annonce l’organisation, le 5 Mars 2026, de sa toute première Journée Alzheimer, une extention significative du programme du congrès qui souligne le rôle croissant de la radiologie face à l’un des problèmes de santé publique les plus urgents de notre époque...
11/02/2026 -

L'ECR évolue avec de nouveaux formats proposés
L’European Congress of Radiology (ECR) revient à Vienne comme à chaque fin d’hiver, pour des moments de formation et de partages au sein de la communauté mondiale de l'imagerie médicale.
30/01/2026 -

Les Master class Bracco sont de retour en 2026
Après l’audit par les pairs, deux nouveaux sujets seront traités par des experts à l’occasion des Master class Bracco 2026. Celui du 18 Mars 2026 évoquera l’IA en sénologie, tandis que celui du 2 Avril 2026 aura pour thème principal les infections pulmonaires en radiologie.
21/01/2026 -


L'échographie pour guider les pratiques d'injection d'acide hyaluronique
L’injection d’acide hyaluronique sur le visage peut provoquer un risque d’occlusion vasculaire. Une étude présentée au dernier congrès de la RSNA a montré que l’échographie peut aider à traiter ces complications potentiellement graves. Des injections guidées par l’échographie pourraient également am...
09/12/2025 -

Save the date : les JFR Urgences 2026
La Société Française de Radiologie organise, les 26 et 27 Mars 2026, à l’Hôtel Villa M à Marseille, les JFR Urgences 2026. Cet événement pluriprofessionnel réunira radiologues, MERM, urgentistes, cliniciens spécialisés et soignants de terrain pour deux journées de travail autour de la gestion de la...
03/12/2025 -

Optimisez vos protocoles de TDM grâce aux webinaires Eurosafe Imaging
L’European Society of de radiology (ESR) vient de publier les chiffres d'audience record obtenus par le premier épisode de sa série de webinaires EuroSafe Imaging 2025, « Optimisation en tomodensitométrie : les bonnes pratiques et les erreurs à éviter », qui a été diffusé le 14 octobre 2025.
07/11/2025 -

Record du nombre d'abstracts reçus pour l'ECR 2026 !
L’European Society of Radiology (ESR) vient d'annoncer un nombre record de soumissions de résumés pour son congrès annuel ECR 2026 qui se tiendra du 4 au 8 mars 2026 à l’Austria Center de Vienne (Autriche).
16/10/2025 -
LETTRE D'INFORMATION
Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !
Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.


