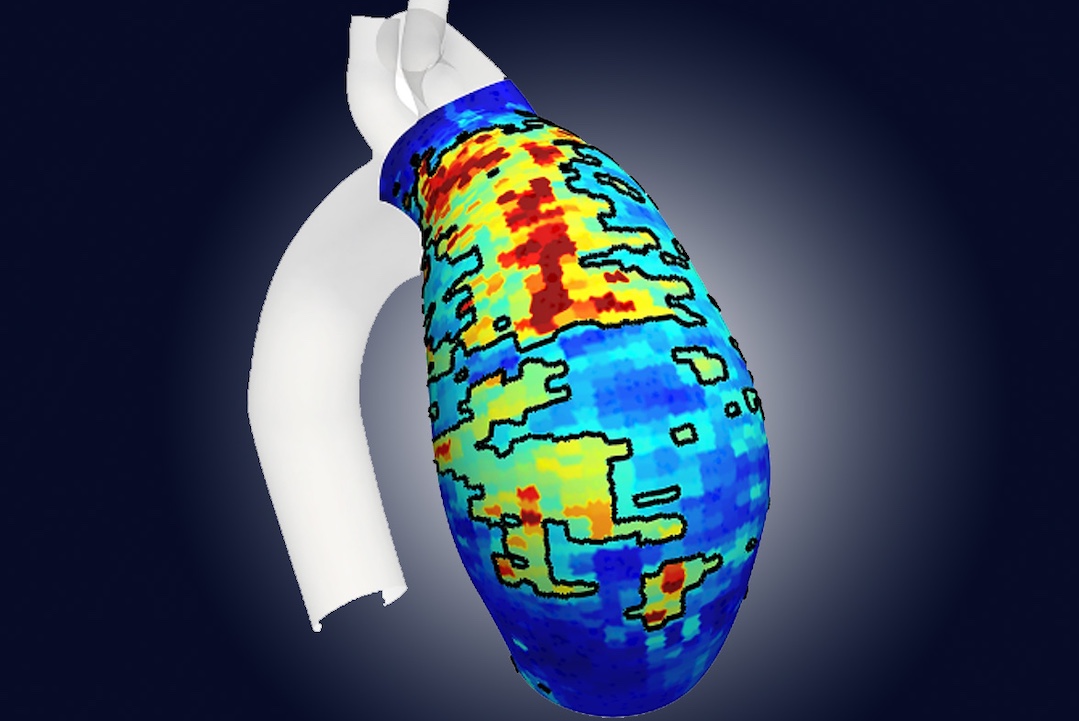Les dégâts structurels cérébraux engendrés par le SRAS-CoV-2
Une étude anglaise a tenté de comparer les images IRM cérébrale de patients COVID avant et après l’infection. Dans un article publié dans la Revue Nature, ils se demandent su les lésions sur la matière grise sont réversibles ou persistantes à terme.
La Revue Nature a récemment publié un article anglais élaboré par des chercheurs qui ont comparé les structures cérébrales de patients par IRM, avant et après leur infection par le COVID-19.
Des répercussions cérébrales connues de la maladie COVID-19
Des recherches précédentes ont identifié des défauts de matière grise dans les régions orbitofrontale et parahippocampique, mais les chercheurs ont voulu savoir si l'impact de l'infection par le SRAS-CoV-2 peut être détecté dans des cas plus bénins, et si cela peut révéler d'éventuels mécanismes contribuant à la pathologie cérébrale. Ils ont donc étudié les changements cérébraux chez 785 participants (âgés de 51 à 81 ans) issus de la UK Biobank, à partir de deux explorations IRM distantes, dont 401 cas qui ont été testés positifs au SRAS-CoV-2 entre les deux examens et 384 contrôles.
L’IRM pour évaluer les changements au niveau de la matière grise avant et après l’infection
Les données d'imagerie pré-infection réduisant la probabilité que des facteurs de risque préexistants soient interprétés à tort comme des effets de la maladie, ils ont identifié une plus grande réduction de l'épaisseur de la matière grise et du contraste tissulaire dans le cortex orbitofrontal et le gyrus parahippocampique, des changements plus importants dans les marqueurs de lésions tissulaires dans les régions fonctionnellement connectées au cortex olfactif primaire et une plus grande réduction de la taille globale du cerveau. Les participants infectés ont également montré en moyenne un déclin cognitif plus important entre les deux explorations.
Des dégâts réversibles ou persistants à terme ?
Ces résultats d'imagerie cérébrale principalement limbiques peuvent être les marqueurs in vivo d'une propagation dégénérative de la maladie par les voies olfactives, d'événements neuro-inflammatoires ou de la perte d'input sensoriel due à l'anosmie. Des explorations supplémentaires montreront si ces changements peuvent être partiellement réparés ou si ces effets persisteront à long terme. « Ces changements anormaux sont-ils la marque de la propagation des effets de la maladie sur le cerveau, ou du virus lui-même ? Préfigurent-ils une future vulnérabilité du système limbique en particulier, y compris de la mémoire ? Cela reste à déterminer », indiquent les chercheurs.
SUR LE MÊME THÈME


La TEP amyloïde révèle des biomarqueurs de l'Alzheimer chez les patients obèses
Des chercheurs ont présenté, à l’occasion du congrès de la RSNA 2025, la première étude évaluant l'impact de l'obésité sur les biomarqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer. En utilisant la TEP amyloïde, ils ont confirmé l’augmentation de ces biomarqueurs jusqu'à 95 % plus rapide chez les personne...
11/12/2025 -


L'IRM fonctionnelle explique les comportements fanatiques à travers celui des supporters de football
En étudiant l'activité cérébrale des supporters de football par IRM fonctionnelle, des chercheurs ont découvert que certaines régions du cerveau s'activaient lors du visionnage de matchs de leur équipe favorite, déclenchant des émotions et des comportements positifs et négatifs. Dans un article publ...
18/11/2025 -


Des protocoles de tractographie IRM, un espoir pour mieux explorer le cerveau dans le maladie d'Alzheimer
La tractographie par IRM devient un outil pertinent pour évaluer les flux dans les faisceaux de fibres cérébrales. Une étude italienne publiée dans la Revue European Radiology explore la complexité du faisceau cingulaire par tractographie probabiliste et expérimente plusieurs protocoles d’acquisitio...
04/11/2025 -


Consensus européen autour de l'adoption clinique des QReports pour l'IRM de la SEP
Les QReports, outils essentiels pour le diagnostic et le suivi de la SEP par IRM, ont besoin d’un consensus scientifique pour être utilisés en pratique clinique. Des experts européens de cette pathologie ont été appelés à se prononcer sur les critères d’élaboration de cet outil et des recommandation...
13/10/2025 -


Mieux identifier par IRM les effets secondaires des traitements anti-amyloïde
GE HealthCare a récemment conclu un accord pour acquérir icometrix, une entreprise spécialisée dans l’analyse d’imagerie cérébrale assistée par IA pour les troubles neurologiques.
23/09/2025 -

Save the date : les sessions SFNR aux JFR 2025
La Société Française de Neuroradiologie (SFNR) sera très présente aux Journées Francophones de Radiologie (JFR) 2025, avec un programme d’une grande diversité, alliant avancées techniques, enjeux cliniques et perspectives d’avenir.
22/09/2025 -

Le programme pluridisciplinaire PREDICTOM pour la détection précoce de l'Alzheimer est lancé
La détection précoce de la maladie d’Alzheimer est l’un des sujets les plus traités par la communauté scientifique médicale. Le programme PREDICTOM, financé principalement par l’Union Européenne et qui vient d'être lancé, fait partie des travaux de recherche qu’il faudra suivre dans un futur proche.
16/09/2025 -
LETTRE D'INFORMATION
Ne manquez aucune actualité en imagerie médicale et radiologie !
Inscrivez-vous à notre lettre d’information hebdomadaire pour recevoir les dernières actualités, agendas de congrès, et restez informé des avancées et innovations dans le domaine.